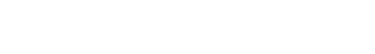Quand il arrive sur scène, on croit qu’il vient de déménager le piano. Avec ses larges épaules et sa taille impressionnante, Yuri Boukoff aurait sans doute pu faire un excellent discobole. Mais la profession n’est pas sûre, les champions olympiques craignent en ce moment le chômage technique.
Personne ne se plaindra qu’il a choisi d’être pianiste car il fait profiter la musique de sa force et de sa santé. Bon nombre de ses confrères se croient obligés de donner la marque de leur personnalité à chacune des œuvres qu’ils interprètent et de dégager les prétendus arrière-plans métaphysiques enfouis derrière chaque note. Cela donna la sonate Waldstein de M. X…, alors que Boukoff se contente de jouer celle de Beethoven, ce qui au fond n’est pas si mal.
Le géant assis derrière son clavier entame les premières mesures et l’on retrouve aussitôt Beethoven, Schumann ou Prokofiev comme des amis de longue date que l’on reconnaît à leur manière de tourner la poignée de la porte.
Avec la 7° sonate de Prokofiev, ce serait plutôt une entrée fracassante, une irruption de cataclysme. Des paquets de notes qui s’écrasent en grappes, broyées par des mains impitoyables.
Le piano avait d’ailleurs intérêt à se bien tenir. Dompté par une poigne de fer dès la Toccata de Schumann au rythme implacable et laissé pantelant à l’issue du dernier bis d’Albeniz.
La musique ici est vigoureuse, pleine d’une sève robuste. Loin des salons embrumés où l’on toussote sa phtisie dans des mouchoirs de soie.
Le public ravi… et plein de santé.
Gérard Baudouin